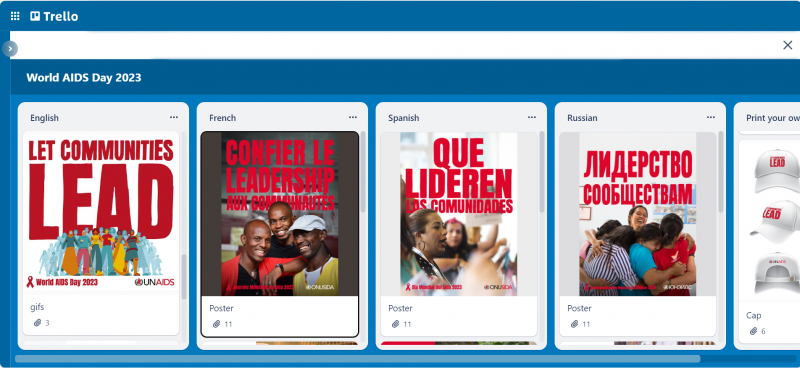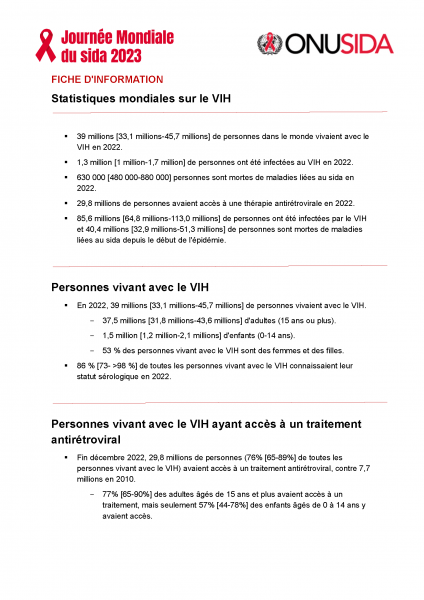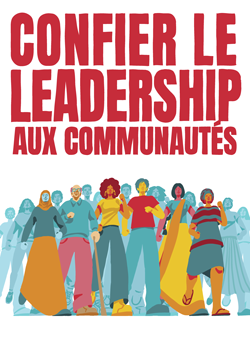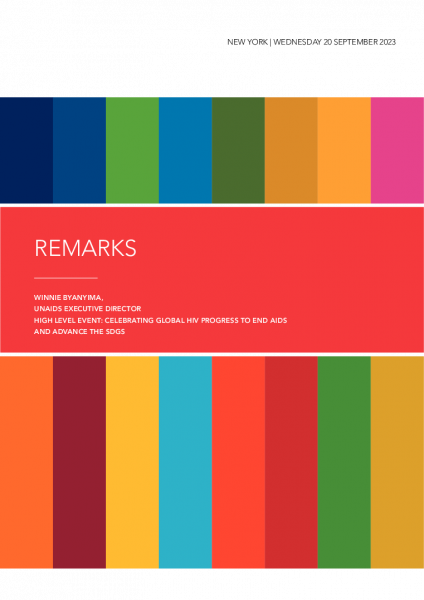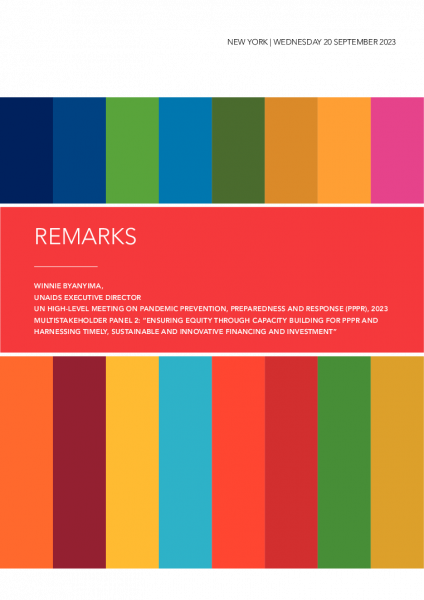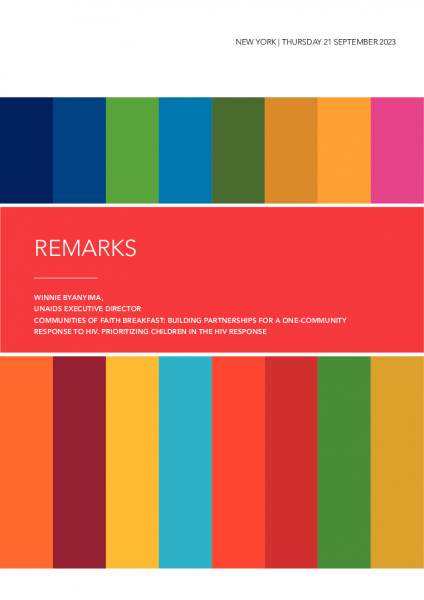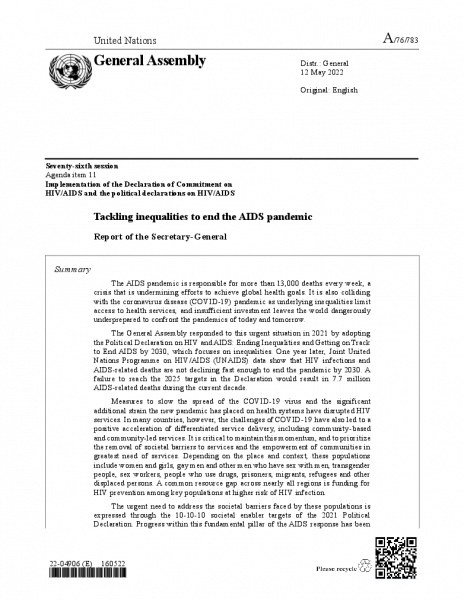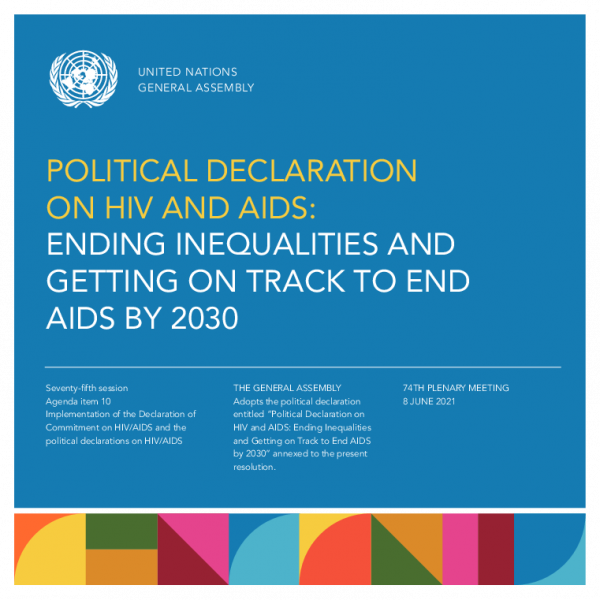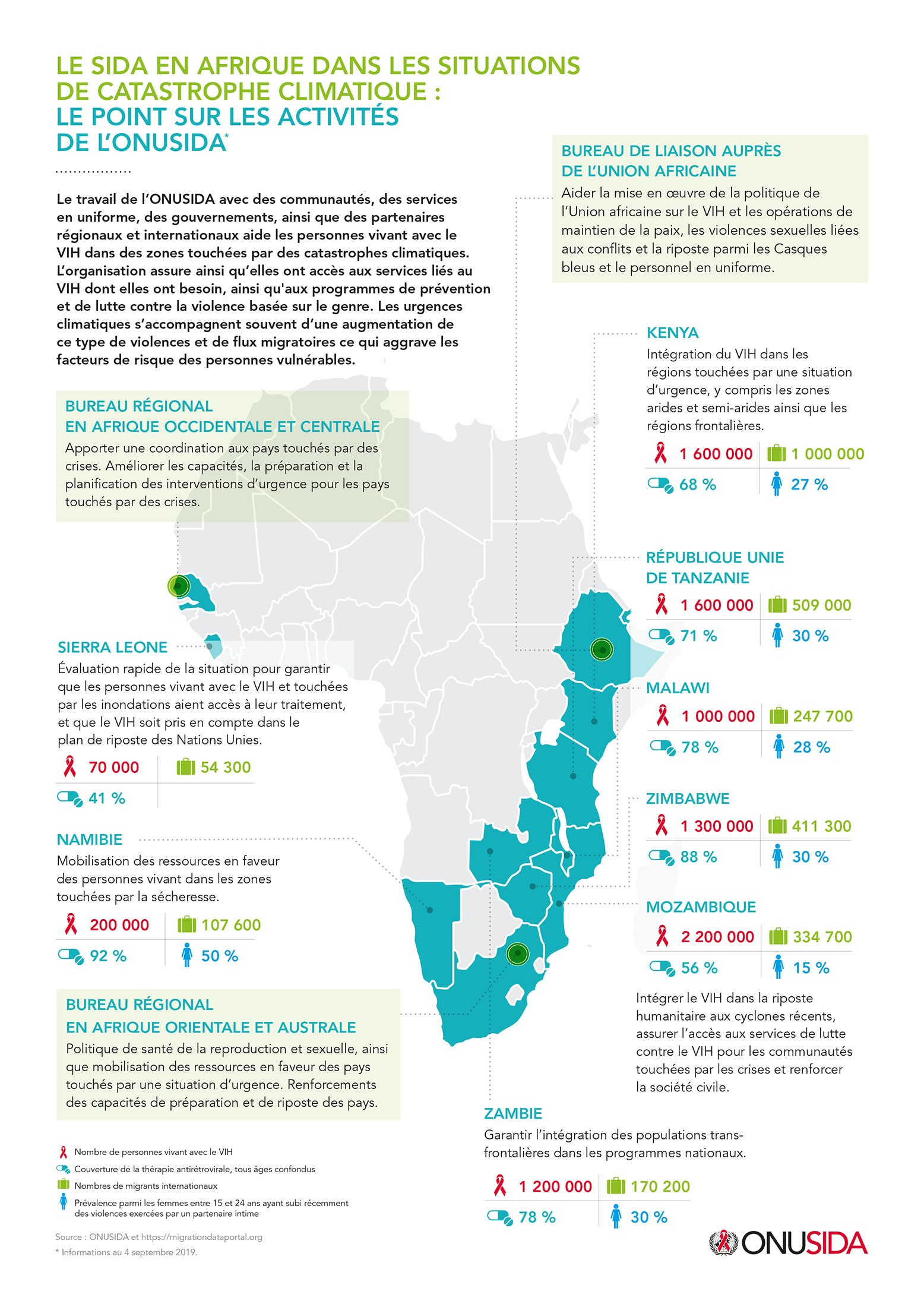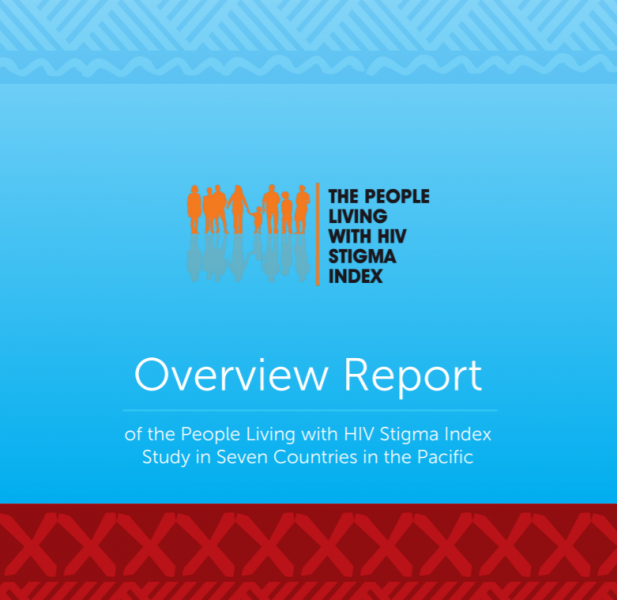GENÈVE, le 29 septembre 2023— Lors de l’Assemblée générale des Nations Unies qui s’est tenue la semaine dernière à New York, le thème de la riposte mondiale au sida, y compris ses succès et les leçons inestimables pour la gestion des pandémies, a fait l’objet de nombreuses discussions. Évoquées au cours de trois réunions de haut niveau sur la santé, du Sommet sur les Objectifs de développement durable (ODD) ou encore dans les remarques faites à l’Assemblée générale et lors d’événements parallèles de haut niveau, les leçons tirées de 40 ans de riposte au VIH, y compris le principe consistant à ne laisser personne de côté, ont été citées à plusieurs reprises dans les discussions sur l’avenir de la santé et de l’égalité pour tous et toutes.
Au cours de sa prise de parole devant l’Assemblée générale, le Président des États-Unis, Joe Biden, a évoqué le succès de la lutte contre le sida, la prenant en exemple pour illustrer ce que la solidarité mondiale et la responsabilité partagée peuvent accomplir. « Le recul des infections et des décès dus au VIH/sida revient dans une portion non négligeable aux efforts déployés par le PEPFAR dans plus de 55 pays qui ont permis de sauver plus de 25 millions de vies », a déclaré le Président Biden. « [Ce résultat] est une preuve tangible de ce que nous sommes capables d’accomplir lorsque nous agissons ensemble pour relever des défis difficiles. C’est aussi une invitation à accélérer de toute urgence nos progrès afin que personne ne soit laissé de côté. »
À l’occasion de l’ouverture du Sommet sur les ODD, le Premier ministre irlandais, Leo Eric Varadkar, a noté qu’à mi-parcours de l’échéance de 2030 et avec seulement 15 % des ODD respectant le calendrier, nous ne sommes pas là où nous souhaiterions être. Il a toutefois ajouté que des progrès sont notables. « Plus de 800 millions de personnes ont obtenu un accès à l’électricité depuis 2015, 146 pays ont atteint ou sont en passe d’atteindre l’objectif d’éliminer les décès évitables des moins de cinq ans, et un traitement efficace contre le VIH a réduit de moitié les décès liés au sida dans le monde depuis 2010, » a déclaré M. Varadkar. « Ces progrès montrent que le changement est possible, que la situation ne doit pas inéluctablement empirer et que la pauvreté, la pollution et les inégalités entre les sexes ne sont pas gravées dans le marbre. Ce sont des tendances qui peuvent être inversées, des problèmes qui peuvent être résolus et des tragédies qui peuvent être évitées. »
Tout en célébrant le succès collectif de la lutte contre le sida, l’ONUSIDA a encouragé les leaders à maintenir le VIH en tête des priorités politiques pour trois raisons. « Premièrement », a déclaré la directrice exécutive de l’ONUSIDA, Winnie Byanyima, « le travail n’est pas encore terminé : après 43 ans de pandémie, plus de 9 millions de personnes attendent encore un traitement vital, plus de 1,3 million de nouvelles contaminations au VIH sont recensées chaque année et une personne est morte chaque minute des suites du SIDA en 2022. Deuxièmement : nous savons comment mettre fin au sida, nous en avons les capacités et nous connaissons la marche à suivre. Troisièmement : la riposte au sida est un investissement judicieux qui a des répercussions positives sur la santé, la société et l’économie. »
Plusieurs ministres, chefs et cheffes d’État ont parlé des défis économiques auxquels ils sont confrontés en raison de crises multiples et concomitantes, ainsi que du besoin de coopération et de solidarité pour surmonter ces crises tout en continuant à réaliser des investissements indispensables dans le développement et la santé. De nombreuses figures politiques ont noté que, même si la volonté politique est présente, les moyens nationaux manquent pour investir dans la santé, l’éducation et la protection sociale.
Le Secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres a rappelé à la communauté internationale qu’il est urgent de repenser et de reconfigurer l’architecture financière internationale pour atteindre les ODD. Il en va de même pour la mission de l’ONUSIDA de mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique et de veiller à pérenniser ces avancées bien au-delà de 2030. L’éradication du sida nécessite des moyens nouveaux et durables, ainsi qu’un discours politique différent sur le financement du développement. L’ONUSIDA a attiré l’attention sur l’importance du maintien des financements bilatéraux pour le PEPFAR et des financements multilatéraux pour le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.
Elle a indiqué qu’à l’heure où nous développons une architecture mondiale pour la prévention, la préparation et la riposte aux pandémies, nous devons tirer parti de plus de 40 ans de riposte au sida, car celle-ci incarne la prévention, la préparation et la riposte aux pandémies.
Elle a par ailleurs mis en avant l’importance des ripostes dirigées par les communautés, car elles sont essentielles pour atteindre les groupes marginalisés et les personnes les plus affectées par les pandémies. L’ONUSIDA a souligné que l’Accord sur les pandémies doit reconnaître la place centrale des ripostes dirigées par les communautés et engager les États membres à inclure les communautés et la société civile dans la prise de décision, la planification, l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi.
L’appel à mettre fin aux inégalités a été un thème central du message de l’ONUSIDA lors de l’Assemblée générale des Nations Unies. L’ONUSIDA a insisté sur la nécessité d’un accès équitable et abordable aux produits médicaux vitaux et a souligné la manière dont les inégalités alimentent et prolongent les pandémies. L’ONUSIDA a défendu le recours à des indicateurs, des objectifs et des systèmes de responsabilisation afin de ne pas disperser les efforts de la riposte, mais aussi pour faire progresser les droits humains en vue d’améliorer la santé publique. Elle a par ailleurs averti que les violations des droits humains érodaient la confiance et éloignaient des personnes des services de santé.
Enfin, l’ONUSIDA a appelé à une approche multisectorielle/pour l’ensemble de la société afin de prévenir, préparer et répondre efficacement aux pandémies, car ces dernières ne sont pas seulement des crises sanitaires. Elles présentent également des défis politiques, sociaux et économiques qui nécessitent une action transformative de la part de tous et toutes.
La directrice exécutive de l’ONUDC, Mme Ghada Waly, s’est exprimée au nom des coparrainants de l’ONUSIDA. Elle a reconnu que « le partenariat multisectoriel sur le VIH/sida est plus important que jamais. Il concentre le savoir-faire, les capacités et les avantages comparatifs de 11 coparrainants. Ce partenariat peut servir d’exemple pour élaborer la stratégie pour les ODD. »
ONUSIDA
Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) guide et mobilise la communauté internationale en vue de concrétiser sa vision commune : « Zéro nouvelle infection à VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié au sida. » L’ONUSIDA conjugue les efforts de 11 institutions des Nations Unies – le HCR, l’UNICEF, le PAM, le PNUD, l’UNFPA, l’UNODC, ONU Femmes, l’OIT, l’UNESCO, l’OMS et la Banque mondiale. Il collabore étroitement avec des partenaires mondiaux et nationaux pour mettre un terme à l’épidémie de sida à l’horizon 2030 dans le cadre des Objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, consultez le site unaids.org, et suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube.