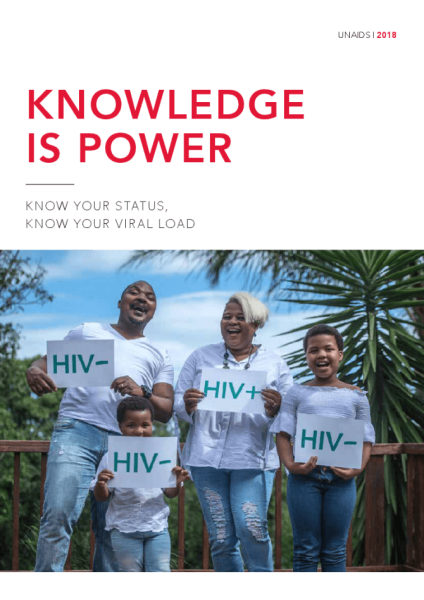Marquant une étape significative en direction des objectifs d’accès universel du pays, Fidji a voté une loi dépénalisant l’homosexualité consentie dans le cadre du Décret national sur la criminalité (Fiji National Crime Decree) le 1er février 2010. Grâce à cette loi, Fidji devient le premier pays des Iles du Pacifique doté de lois contre la sodomie datant de l’époque coloniale à dépénaliser officiellement les rapports sexuels entre hommes*.
Le nouveau décret sur la criminalité supprime toutes les clauses faisant référence à la ‘sodomie’ et aux ‘actes contre nature’, et utilise un langage neutre qui respecte l’égalité entre les sexes dans le reste de la section sur les délits sexuels.
« Nous souhaitons féliciter le gouvernement de Fidji pour avoir pris une mesure audacieuse en supprimant une loi punitive » a déclaré Stuart Watson, Coordonnateur de l’ONUSIDA pour le Pacifique.
« Cette réforme représente une étape importante en direction de la mise en place d’un cadre juridique respectueux des droits, non seulement pour les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, mais pour l’ensemble de la communauté ».
Le VIH, la loi et les droits de la personne dans le Pacifique
En 2007, le Secrétariat de l’ONUSIDA et le PNUD ont examiné les lois de 15 pays des Iles du Pacifique relatives aux questions en rapport avec le VIH, y compris la discrimination, le respect de l’éthique, l’accès au traitement, la vie privée et la confidentialité. Ce projet incluait : les Iles Cook, les Etats fédérés de Micronésie, Fidji, Kiribati, les Iles Marshall, Nauru, Niue, Palau, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, les Iles Salomon, Tokelau, Tonga, Tuvalu et Vanuatu.
Cette réforme représente une étape importante en direction de la mise en place d’un cadre juridique respectueux des droits, non seulement pour les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, mais pour l’ensemble de la communauté.
Stuart Watson, Coordonnateur de l’ONUSIDA pour le Pacifique.
A la suite de cet examen, le bureau de l’ONUSIDA pour le Pacifique et le Centre pour le Pacifique du PNUD ont organisé, avec l’Equipe ressource du Pacifique pour les droits régionaux (RRRT), une réunion en Nouvelle Zélande avec les Ministres de la Justice (Attorney Generals) et les Ministres de la Santé de ces pays. Avec les plus grands experts internationaux et régionaux, ils ont discuté du VIH, de la loi et des droits humains par rapport aux lois spécifiques de chaque pays de la région qui ont un impact sur la riposte au VIH. L’objectif était de mieux soutenir des ripostes juridiques à l’épidémie efficaces et respectueuses des droits.
Les participants ont réaffirmé l’importance de la mise en œuvre de la ‘Stratégie régionale du Pacifique sur le VIH/sida 2007-2008’ avalisée par les Chefs de gouvernements du Pacifique à Samoa en 2004. Cette stratégie régionale est un plan global qui souligne l’importance du respect des droits humains dans les interventions en rapport avec le VIH.
Appel en faveur de l’examen, de la réforme et de la promulgation d’une législation appropriée
Les Ministres de la Justice et les Ministres de la Santé ont ensuite lancé un appel en faveur de l’examen, de la réforme et de la promulgation d’une législation appropriée qui renforce les droits humains universels afin de protéger et de garantir la dignité de toutes les personnes affectées par le VIH, qui promeut une riposte intégrée contre le VIH en tenant compte des liens réciproques entre droits sexuels et reproductifs et prévention du VIH, et qui protège en outre les droits des personnes vivant dans des communautés indépendamment de leur sexe, sexualité ou identité de genre ou sexuelle, ou autres caractéristiques identitaires.
Suite à cette première consultation parrainée par les Nations Unies, la République des Iles Fidji a demandé à l’ONUSIDA et à l’OMS une assistance technique pour l’aider à élaborer pour le pays une loi sur le VIH qui soit complète et respectueuse des droits. Parallèlement à la rédaction du projet de loi sur le VIH et à un processus de consultation sur ce projet, et sur la base des décisions de la Haute Cour, la loi de l’époque coloniale qui pénalisait les rapports sexuels entre hommes a été supprimée. Ce projet est devenu une loi le 1er février 2010 avec la promulgation à Fidji du Décret national sur la criminalité.
Le VIH dans le Pacifique
Le rapport intitulé Le point sur l’épidémie de sida 2009 indique que la prévalence du VIH est généralement très faible dans le Pacifique par rapport à ce qu’elle est dans d’autres régions. Dans ces petits pays iliens, la prévalence du VIH chez les adultes a tendance à être très inférieure à 0,1 %. Les épidémies nationales résultent très majoritairement d’une transmission sexuelle du virus, et ce, bien que les groupes de population les plus affectés varient fortement au sein de la région.
Selon le Rapport de la Commission sur le sida dans le Pacifique on ne connaît pas l’ampleur de la transmission du VIH lors de rapports sexuels entre hommes dans le Pacifique. Dans la mesure où la majorité de ces rapports sont cachés, illégaux et niés dans la région, ils ne sont pas pris en compte de manière appropriée dans la plupart des plans nationaux de riposte au VIH.
La surveillance comportementale recense les rapports sexuels entre hommes parmi les jeunes dans les Iles Salomon, au Vanuatu et à Samoa, ainsi que dans la police et l’armée dans les Iles Fidji, chez les patients qui fréquentent des dispensaires de traitement des IST dans les Iles Fidji et à Samoa, et chez les marins à Kiribati. Malgré l’existence d’un lien possible entre des rapports sexuels non protégés entre hommes et des taux relativement élevés d’infection à VIH en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Fidji, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et à Guam, aucun de ces pays n’a récemment réalisé d’études de surveillance comportementale ou d’études qualitatives concernant les caractéristiques de ces hommes, ou initié de campagne ciblée pour encourager les pratiques sexuelles à moindre risque.
Les principaux obstacles à l’efficacité de telles campagnes sont à la fois liés à la stigmatisation sociale et à l’illégalité des rapports homosexuels. Non seulement les hommes ont honte, ou sont embarrassés, de révéler la nature de leur activité sexuelle, mais en plus on les dissuade de s’intéresser à ce qu’ils devraient savoir pour réduire leur risque ou pour acheter des préservatifs.
Stuart Watson considère que la réforme de la loi va permettre de mieux sensibiliser les communautés qui sont difficiles à atteindre.
« La modification de la loi est un pas en avant considérable grâce auquel toutes les communautés vont pouvoir être sensibilisées avec des programmes éducatifs et des ressources de prévention. Cela devrait permettre à tous d’avoir un meilleur accès aux services de prévention du VIH en réduisant le risque d’infection par le VIH et les IST » a déclaré M. Watson.
* Les relations entre hommes sont illégales et passibles d’emprisonnement dans les 9 pays iliens du Pacifique suivants : les Iles Cook, Kiribati, Nauru, Palau, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, les Iles Salomon, Tonga, Tuvalu. Dans 13 autres pays et territoires du Pacifique, les rapports sexuels entre hommes ne sont pas passibles de poursuites pénales.