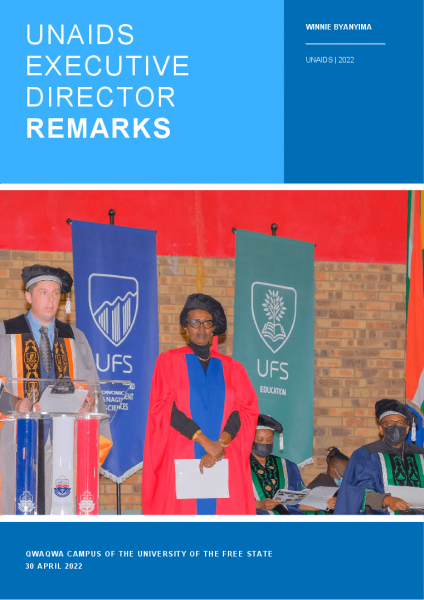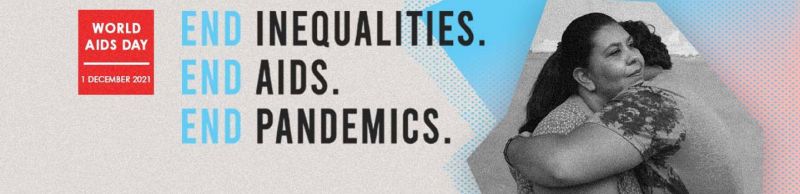Edwin Cameron
Le 1er décembre, nous célébrons la Journée mondiale de lutte contre le sida.
Cette année, nous avons aussi fêté un bien triste anniversaire. Le 5 juin 2021 a en effet marqué les quarante ans depuis le premier regroupement officiel de cas inquiétants et inexpliqués de maladies et de décès qui allaient plus tard prendre le nom de sida. Ces quarante dernières années ont vu d’énormes progrès médicaux et scientifiques, mais la mort et la stigmatisation restent beaucoup trop présentes autour de nous.
De trop nombreuses personnes ne se font pas dépister ou meurent dans le silence et la honte. Le traitement n’atteint pas celles et ceux qui en ont besoin, et les inégalités et la discrimination entravent notre riposte mondiale.
Aujourd’hui, je suis en mesure de m’exprimer à ce sujet, car le hasard de la vie m’a permis de survivre au sida. Il y a 24 ans, j’ai commencé un traitement antirétroviral qui m’a sauvé la vie. Cela m’a fait prendre conscience des effets délétères des lois et les politiques discriminatoires vis-à-vis des personnes mises en danger par cette redoutable épidémie. Laissez-moi vous raconter.
Mon infection au VIH remonte plus ou moins à Pâques 1985. J’étais un jeune trentenaire en début de carrière. À cette terrible époque, aucun traitement n’existait : contracter le VIH revenait à signer son arrêt de mort. Toutes les personnes qui avaient ou étaient suspectées d’avoir le VIH ou le sida suffoquaient sous une chape de stigmatisation et de peur.
Comme beaucoup, je n’ai pas révélé mon statut sérologique. J’espérais contre toute attente échapper au spectre de la mort. Peine perdue. Le sida a pris possession de mon corps douze ans après mon infection. Je suis tombé terriblement malade et j’ai vu la mort en face.
Mais mes privilèges m’ont donné accès à un traitement et aux soins. J’étais entouré de l’amour de ma famille et de mes amis, et je voulais reprendre mon travail en tant que juge. J’ai survécu en ayant accès rapidement au traitement antirétroviral.
En 1999, j’ai annoncé publiquement ma séropositivité. J’ai expliqué que les antirétroviraux m’avaient protégé d’une mort certaine, mais que des millions d’autres personnes en Afrique n’y avaient pas accès.
Aujourd’hui, je fais figure d’exception en Afrique : j’occupe un poste officiel, je parle ouvertement de mon homosexualité et de ma vie avec le VIH. Je ne le dis pas pour attirer les compliments, mais parce la honte, la peur, l’ignorance et la discrimination continuent de réduire trop de personnes au silence dans trop d’endroits dans le monde.
D’expérience, au plus profond de moi, je connais le pouvoir de la stigmatisation, de la discrimination, de la haine et de l’exclusion.
Et, après vingt-cinq ans au poste de juge, j’ai été témoin de trois choses. Premièrement, la stigmatisation et la honte ont un effet destructeur. Deuxièmement, les lois punitives et discriminatoires nuisent aux ripostes de santé publique. Troisièmement, le manque de protection légale et de recours juridique alourdit davantage le terrible fardeau du VIH/SIDA.
Les raisons expliquant pourquoi l’égalité est au cœur de la riposte au VIH/SIDA
Environ 37,7 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde. Pour la plupart d’entre nous, des progrès réconfortants ont atténué le fardeau de la mort, de la maladie et de la honte. Aujourd’hui, nous sommes en mesure d’atteindre notre objectif 90-90-90 (90 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, 90 % d’entre elles ont accès au traitement et 90 % de ces dernières ont une charge virale indétectable).
En Afrique, l’épidémie présente toutefois un visage tragique. L’Afrique subsaharienne concentre deux tiers des cas de VIH, et les jeunes femmes représentent 63 % des nouvelles infections dans cette région.
Voici un autre chiffre tout aussi préoccupant : les populations clés (travailleur-ses du sexe, membres de la communauté LGBTQI+, toxicomanes, population carcérale, hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes) représentent 65 % des nouvelles infections au VIH dans le monde.
Face à ces faits parlants, la nouvelle stratégie annoncée par l’organisation des Nations Unies dédiée à la lutte contre l’épidémie, l’ONUSIDA, a été la bienvenue. Ce document souligne la manière dont les inégalités font les beaux jours du sida. Par conséquent, leur éradication est au cœur de la nouvelle approche de l’ONUSIDA.
Une approche basée sur les droits va dans le bon sens. Elle montre que les droits humains sont tous interconnectés. L’épidémie de sida en est la preuve : le droit à la santé ne peut pas être dissocié, en théorie ou en pratique, du droit à l’égalité.
La conclusion à en tirer est sans équivoque : pour surmonter le sida d’ici 2030, nous devons renforcer l’égalité au sein de l’humanité.
La bonne nouvelle, c’est que la protection et le respect des droits permettent d'endiguer le sida. Les données probantes de l’ONUSIDA montrent très clairement comment « les inégalités alimentent l’épidémie de VIH et bloquent les progrès nécessaires pour mettre fin au sida ». Comme l’indique à juste titre The Lancet : « Le succès de la riposte au VIH repose sur l’égalité – non seulement l’égalité dans l’accès à la prévention, à la prise en charge et au traitement... mais aussi l’égalité face à la loi. »
Les programmes de défense des droits humains et les réformes sensées du droit réduisent la stigmatisation et la discrimination. Pourtant, le manque de financements et d’efforts est criant. La situation est simple : dans beaucoup trop de sociétés, le spectre de la stigmatisation s’abat sur les personnes vivant avec le VIH et le sida ou exposées à ces deux fléaux. La discrimination est présente dans les sociétés et leurs lois, et l’abrogation des lois punitives non avenues se fait à un rythme désespérément lent.
Non aux lois punitives et discriminatoires
Les lois punitives et discriminatoires ciblent les populations clés les plus exposées au VIH/SIDA. Elles ciblent l’orientation sexuelle, l’identité de genre, le statut sérologique, l’usage de drogues et le travail du sexe.
Ainsi, trop de pays criminalisent encore les personnes LGBTQI+. De plus, le risque de contracter le VIH est extrêmement plus élevé chez les femmes transgenres.
Et personne ne fait l’objet de discrimination uniquement pour un seul motif. Les répercussions toxiques de la discrimination se mêlent à des formes variées d’environnements hostiles. On parle ici à juste titre d’« intersectionnalité ». Par exemple, une travailleuse du sexe est attaquée pour sa sexualité, son sexe, son statut socio-économique et son statut sérologique vis-à-vis du VIH. Le résultat est inquiétant : les travailleur-ses du sexe ont 26 fois plus de risques de contracter le VIH.
Dans l’ensemble, la force brutale du droit pénal musèle le bon travail de la lutte contre le sida. Elle intensifie les inégalités, les inégalités et l’exclusion.
De fait, la criminalisation des personnes vivant avec le VIH et la répression envers les populations clés compromettent les efforts de prévention. Elles réduisent l’accès aux services, ce qui peut augmenter les infections au VIH.
Ces lois punitives ne se limitent pas à « laisser les gens de côté ». Elles les marginalisent activement. Elles augmentent la peur et la stigmatisation, et tiennent les personnes les plus exposées à distance des services de santé et des protections sociales.
Winnie Byanyima, Directrice exécutive de l’ONUSIDA, a confié un souvenir poignant : « La stigmatisation a tué mon frère. Il était séropositif et serait encore parmi nous s'il était allé chercher ses antiviraux au dispensaire, mais il a eu peur d’être reconnu là-bas et jugé par des personnes qui le connaissaient. » Sa conclusion ? « Nous devons lutter contre la stigmatisation et la discrimination, car elles tuent. »
D’autres conséquences nuisent à nos sociétés. La discrimination s’immisce dans la collecte de données et de preuves, car les populations criminalisées et stigmatisées se retrouvent ainsi souvent sous-représentées ou absentes.
Cela reflète leur réalité au quotidien : elles sont confrontées à une forme extrême de stigmatisation, leur existence est niée, invisibilisée et effacée.
Cette oblitération est extrêmement néfaste. Cela signifie que nous ne savons pas si les services sont accessibles et adaptés. Cela signifie que des informations importantes risquent de ne pas être obtenues. Cela signifie que la violence et la discrimination à l’encontre des populations invisibles restent inconnues et non résolues.
Nous devons donc demander : Comment peut-on éliminer les obstacles à l’accès aux services si nous ne voyons même pas les personnes qu’ils écrasent ? Que pouvons-nous faire ?
Une chose est sure : nous pouvons aider à créer des environnements juridiques favorables, émancipatoires et qui apportent une protection.
Un environnement juridique favorable
La riposte au sida est liée aux valeurs démocratiques et à des systèmes juridiques efficaces. L’état de droit, la liberté d’expression, la liberté de manifester et d’autres droits humains fondamentaux sont importants.
Il est essentiel de créer un environnement juridique favorable. Cela signifie que nous avons recours à la loi pour autonomiser plutôt que pour opprimer. Nous devons nous défaire des lois pénales qui punissent sans raison. Il s’agit de parvenir à l’égalité devant la loi.
L’accès à la justice, la revendication de réformes juridiques, la sensibilisation ainsi que les campagnes éducatives et le dynamisme militant de la société civile, qui n’oublie pas les populations clés, sont essentiels. Tout cela favorise un changement positif et aide à placer les auteurs de violations des droits humains devant leurs responsabilités.
C’est ce que nous ont montré les quarante dernières années. Des militantes et militants fervents, intègres et courageux d’ACT UP à New York et de Treatment Action Campaign en Afrique du Sud sont parvenus à des avancées vitales dans le traitement du sida. Ces hommes et ces femmes ont lutté pour la justice et pour trouver la riposte au sida la plus efficace. En Afrique du Sud, la société civile a attaqué la politique de l’autruche du gouvernement du président Mbeki devant la plus haute Cour et cette dernière a ordonné au gouvernement de commencer à fournir des ARV.
Pour eux, comme pour moi, et pour encore beaucoup trop de personnes aujourd’hui, il s’agissait d’une bataille dont l’issue déterminait la vie ou la mort, le bien-être ou la maladie, la science ou l’effet pernicieux des idées préconçues, la discrimination ou la justice et l’égalité, et la façon dont des pratiques justes instaurent des politiques de santé publique sensées et qui sauvent des vies.
La nouvelle stratégie de l’ONUSIDA s’inscrit dans cette dynamique. Elle vise à garantir l’accès à la justice et la reddition de compte en faveur des populations clés et des personnes vivant avec le VIH ou affectées par le virus. Elle appelle à juste titre à renforcer la collaboration entre les principales parties prenantes, à soutenir les programmes de connaissance des droits et à élargir l’assistance juridique. Elle prévoit également un engagement considérable, des investissements plus importants et une diplomatie stratégique de la part de la communauté internationale.
La pandémie de COVID-19 n’a pas changé ces objectifs, mais son impact sur les inégalités en a accru l’urgence. Les confinements anti-infection ont perturbé les services liés au VIH et au sida (les établissements de santé ont été fermés ou les ressources ont été réallouées à la COVID-19 ou il y a eu des pénuries d’antirétroviraux).
D’autre part, des leçons ont été tirées et la technologie de l’ARNm pourrait accélérer la découverte d’un vaccin contre le sida.
Bien qu’il n’y ait toujours pas de remède, le sida n’est plus synonyme d’une mort assurée. Vingt-quatre ans après avoir pris mes premiers antirétroviraux, je mène une vie heureuse et épanouie. Notre défi réside en nous-mêmes et dans nos sociétés : il s’agit de surmonter la peur, la discrimination et la stigmatisation pour garantir que les traitements vitaux et les messages soient accessibles de manière juste et équitable.
L’éradication du sida d’ici 2030 est un objectif réaliste. Mais pour y parvenir, nous devons respecter, protéger et satisfaire les droits fondamentaux des personnes vivant avec le VIH et exposées au risque d’infection. Nous devons adopter les aspirations démocratiques, placer les populations clés au centre de notre riposte, fournir des ressources pour réduire les inégalités et les injustices, et promouvoir les environnements juridiques qui nous permettront de mettre fin au sida.
Ces 40 dernières années ont été difficiles, mais elles nous ont appris une chose : nous pouvons mettre fin au sida si le soutien, la recherche scientifique, la concentration et l’amour sont au rendez-vous.